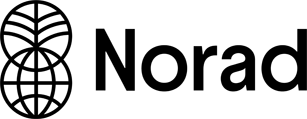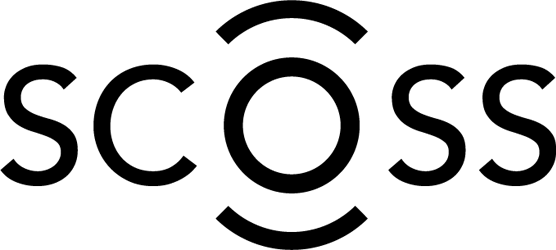Main Article Content
STI/HIV co-infections in UCH, Ibadan, Nigeria
Abstract
RÉSUMÉ
On reconnaît mal les infections sexuellement transmissibles (ISTs) et elles ne sont pas traitées de manière adéquate au Nigéria malgré le fait qu'elles constituent un risque majeur pour la transmission du VIH. Le but de cette étude était d'établir le taux de co-infection des ISTs et du VIH et d'obtenir des données socio-démographiques et de santé de reproduction liées aux ISTs. On a besoin de cette information de toute urgence pour formuler des stratégies de contrôle des ISTs/VIH. Tous les malades consentants dont l'histoire a montré les ISTs, qui ont fréquenté la clinique des ISTs au Centre Hospitalier Universitaire (UCH) à Ibadan entre les mois de mars et denovembre 2001 ont fait l'objet de l'étude. Parmi les 210 malades qu'on a vus, 98 (46,7%) étaient des mâles alors que 112 (53,3%) étaient des femelles (p > 0,05). Cent cinquante-six (74,3%) d'entre eux étaient âgés de 20–39 ans alors que seuls 10(5,1%) étaient des adolescents. Vingt (9,5%) ont fait l'analyse diagnostique des ISTs dont 6 (30%) ont été séropositifs. Parmi ceux qui avaient des ISTs, 8 (40%) avaient la gonorrhée, 8 (40%) avaient la candidose alors que 4 (25%) avaient le Trichomonas vaginalis. Aucune des malades n'avaient des sérums positifs pour les immobilisenes. Le taux de prévalence u VIH était de 21,9%. Les taux les plus élevés ont été constatés chez les malades âgés de 20–29 ans alors qu'aucun adolescent et aucune personne ayant plus de 50 ans n'était séropositif. Cinq (62,5%) des malades qui avaient la gonorrhée étaient séropositifs. Un pourcentage plus bas (25%) de ceux qui avaient la triachomonase étaient séroposoitifs alors qu'aucun de ceux qui avaient la candidose n'était séropositif. Le taux de co-infection des ISTs/VIH était de 30%. Cette étude a révélé un taux élevé de co-infection des ISTs et du VIH, ce qui montre qu'il faut un bon traitement des ISTs comme une manière de réduire la propagation de l'infection du VIH au Nigéria.
Afr J Reprod Health Vol.9 (1) 2005: 42–48